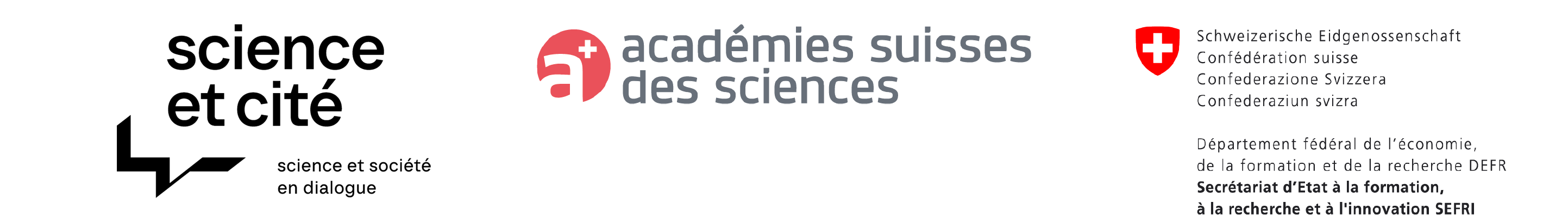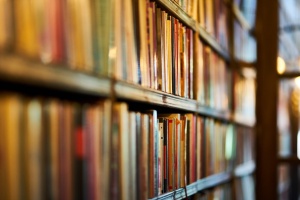Nikola Stosic
Inclusive Communication in Citizen Science Projects: A Necessity for Engagement and Equity
Communication plays a pivotal role in the success of Citizen Science projects. It bridges the gap between scientists and citizens, fostering collaboration and inclusivity. As per Principle 5 of the Swiss Citizen Science Principles, clear communication of expectations is essential for effective project execution. This principle underscores the need for addressing different interest groups appropriately to ensure mutual understanding and cooperation.
 |
Carina Veeckman is working as a senior researcher and PhD candidate at the Vrije Universiteit Brussel, research group SMIT – Digital Inclusion & Citizen Engagement. She is the principal investigator for citizen science and is researching the democratizing potential of this participatory method. |
| Nikola Stosic, Project coordinator Citizen Science at the Science et Cité Foundation. |  |
|
One of the projects presented at ECSA24 was the Urban ReLeaf project. This initiative promotes collaboration between local communities and public authorities to tackle urgent climate issues such as urban greenspace planning, heat stress, and air pollution. By involving citizens in environmental monitoring, the project aims to create greener, more equitable, and resilient cities.
The Urban ReLeaf project recently released an open-access deliverable titled "Blueprint for Inclusive Citizen Science Engagement", and published by the Vrije Universiteit Brussel. This comprehensive report addresses the importance of inclusive engagement strategies, especially for marginalized communities that face significant environmental and climate injustices. The blueprint is a roadmap for more equitable engagement in Citizen Science, providing guidance for other projects aiming to diversify their participant base.
The Importance of Inclusive Communication
Inclusive communication is an approach designed to involve as many people as possible by recognizing and supporting various ways individuals understand and express themselves. This approach is crucial for reducing inequality, promoting social inclusion, ensuring equal access, and fostering participation and interaction. Here are some key aspects of inclusive communication that were gathered during roundtable discussions «Ways to Enhance Diversity and Inclusivity in Citizen Science» with the Urban ReLeaf project:
- Clear Language: Use a writing style that is easy to understand, regardless of the reader's level of education. Sentences should be concise, ideally 15 to 20 words long.
- Clear Layout and Design: Enhance readability, comprehension, and accessibility with thoughtful design. Use authentic images and ensure the content is visually appealing and easy to navigate.
- Inclusive Language: Acknowledge diversity, convey respect, be sensitive to differences, and promote equal opportunities through the language used.
Practical Actions for Inclusive Communication
To foster inclusive communication, consider the following actions:
- Profile: Adapt content to different age groups, provide translations for deaf people, use diverse channels and mediums, engage participants in the field, upscale information levels as needed, use gamification as a motivator, and focus on building relationships rather than large numbers.
- Language: Use non-academic language, remove unnecessary information, provide translation services, and ensure the content is neither too simple nor too complex.
- Layout: Address challenges such as color blindness by choosing appropriate colors, use readable font sizes and styles, include more images than text, and avoid stereotypical photos.
- Iteration/Co-creation: Pre-check and iterate content, proofread thoroughly, and co-create materials with the target audience to ensure relevance and inclusivity.
- Technology: Make links easy to click, provide open access to materials, ensure device responsiveness, and use social media for advertising.
Conclusion
Inclusive communication ensures that diverse perspectives are heard, data quality is improved, and public trust in scientific outcomes is fostered. By adopting the strategies mentioned above, Citizen Science projects can enhance their inclusivity and effectiveness.
For more detailed guidance, we encourage you to consult the Urban ReLeaf Blueprint for Inclusive Citizen Science Engagement. This resource offers a comprehensive guide divided into four phases and eight steps, with additional templates, providing valuable insights for cities and projects aiming to engage a greater diversity of participants.
Created on August 26, 2024
CitSciHelvetia'21 - Connecter les sciences citoyennes en Suisse
La première conférence suisse sur les sciences citoyennes CitSciHelvetia'21 s'est déroulée en ligne et a permis de réunir les acteurs:trices des sciences citoyennes en Suisse et de mettre en réseau leurs différentes approches et projets. Ce mouvement de science citoyenne a pris de l'importance en Suisse et est promu par différentes disciplines et organisations. Qu'elles soient organisées par des hautes écoles, intégrées dans des écoles ou menées comme mouvement de base, les sciences citoyennes en Suisse encouragent la participation du public à la recherche et le dialogue entre la science et la société.

La conférence, organisée par le Citizen Science Center Zurich, par la "partizipative Wissenschaftsakademie", par le Citizen Cyberlab et par Science et Cité, s'est tenue en janvier 2021 et a attiré plus de 190 participants de Suisse et d'ailleurs. Elle a proposé un large programme et a encouragé l'échange d'idées et la discussion sur la recherche participative en Suisse. L'événement comprenait également des panels de keynotes qui ont mis en lumière le rôle des sciences citoyennes dans la société et les opportunités pour les projets de sciences citoyennes en Suisse dans un contexte national et international. La conférence a présenté un grand nombre de projets et d'initiatives de sciences citoyennes, et les participants ont eu l'occasion de présenter leurs projets lors de brefs exposés, de tenir des ateliers et d'échanger des idées. Le « marché des possibilités » a permis d'échanger des idées par le biais de posters ou de vidéos et de mener des entretiens individuels.
Les participants venaient de différentes institutions et organisations académiques en Suisse et la conférence visait à refléter la diversité des initiatives de sciences citoyennes et la diversité des participants.
CitSciHelvetia'25 - Les sciences citoyennes en action
Citizen Science Helvetia 2025 (CitSciHelvetia’25), la conférence suisse des sciences citoyennes et participatives, aura lieu les 5 et 6 juin 2025, à l’Université de Lausanne (UNIL) et portera sur «Les sciences citoyennes en action. Collaborations entre la société civile et les milieux académiques ».
Initiée par la Fondation Science et Cité, soutenue par les Académies suisses des sciences ainsi que par l’UNIL, cette édition est organisée par le ColLaboratoire (Unité de recherche-action, collaborative et participative de l’UNIL). Vous êtes appelé·e à y prendre part en soumettant une contribution sur les enjeux de la collaboration entre société civile et institutions académiques.
Vous faites partie d’une ONG, d’une association, d’une fondation, d’un collectif citoyen, d’une institution publique ? Vous êtes chercheur·euse en sciences de la nature et de l’environnement, en sciences humaines et sociales, en lettres, en droit ou en économie ? Votre action vise à soutenir, accompagner, faciliter les sciences citoyennes et participatives ? Vous débutez dans le domaine ou vous préparez à passer à l’action ?
Vos propositions sont les bienvenues !
Vous trouverez de plus amples informations sur le site de la conférence : https://www.citscihelvetia.ch/
Vous pouvez déposer vos propositions en ligne sur la plateforme dédiée jusqu’au 30 novembre 2024.
Euro-Climhist
En quoi consiste concrètement le projet ?
Euro-Climhist – une base de données paneuropéenne sur l’histoire du climat
Les messages documentés par l’homme sur les conditions météorologiques, qu’ils soient décrits en détail, notés en passant ou mesurés, font partie des sources les plus importantes de l’histoire du climat. Avec Euro-Climhist, les données météorologiques et climatiques historiques sont accessibles grâce à une recherche conviviale, qu’il s'agisse de données météorologiques quotidiennes ou d'événements extrêmes et d'évolutions climatiques à long terme. Euro-Climhist se base sur des observations météorologiques documentées par écrit ou par des images, sur des mesures instrumentales (précoces) et sur des « données proxy » du haut Moyen Âge à nos jours. Ces différentes données fournissent des informations sur les événements météorologiques et leurs conséquences pour l’homme et l’environnement.
Quelles sont les recherches menées par les citoyennes et citoyens ?
La base de données d’Euro-Climhist doit être développée en permanence. Vous pouvez y contribuer ! Avez-vous trouvé des données contemporaines qui manquent dans Euro-Climhist ? Dans ce cas, veuillez nous les communiquer en envoyant des scans de la page de titre et des pages contenant des informations météorologiques à l’adresse de contact Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou, dans le cas de sources d’archives, en nous indiquant le lieu de leur découverte (archives, cote). L’équipe d’Euro-Climhist offre une aide logistique pour la saisie des données.
Exemples de données :
- Journaux météorologiques historiques, enregistrements annuels des dates de récolte et autres activités agricoles ainsi que des observations de phénomènes phénologiques (couverture neigeuse, givrage, floraison, état des feuilles, etc.)
- Données de mesures instrumentales (en particulier avant 1863)
- Images et photos (privées) d'événements historiques extrêmes (p. ex. marques de crues, étendue des dégâts) de bonne qualité avec preuve précise.
- Rapports (de presse) contemporains, inscriptions dans des chroniques, etc. concernant les événements extrêmes historiques suivants :
- Tempêtes et dégâts dus aux tempêtes
- Chutes de grêle
- Dégâts de sécheresse
- Chutes de neige intempestives
- Inondations (locales) (pour la Suisse, surtout pour la période avant 1972)
- Glissements de terrain
- Avalanches dommageables (pour la Suisse, surtout pour la période avant 1950/51).
Une multitude d’informations à ce sujet se trouve dans les histoires locales et les chroniques locales imprimées.
De quelle façon sont traités les résultats ?
Vos données et résultats seront intégrés dans la base de données grâce à l’aide nécessaire de la part des responsables d’Euro-Climhist. Cela doit permettre d'atteindre l’uniformisation nécessaire à la recherche suprarégionale et de garantir en même temps que les spécialistes des différentes régions puissent publier leurs résultats de recherche sous leur nom, sans pour autant devoir reprendre le travail de développement de longue haleine pour une base de données basée sur le web. Pour chaque entrée de données, les auteurs correspondants apparaissent également et peuvent ainsi être cités correctement par les spécialistes.
Science goes Wiki : Chances et défis
Wikipédia est souvent le premier endroit où nous nous rendons lorsque nous souhaitons avoir une vue d'ensemble sur un sujet scientifique. Pourtant, Wikipédia est généralement sous-estimé dans la communication scientifique. Mais, il pourrait jouer un rôle précieux. Wikipedia n'est pas seulement le septième site web le plus visité en Suisse, mais aussi une plateforme importante pour rendre les connaissances scientifiques accessibles à un large public. Lors de notre dernier atelier "How to Wiki", animé par Flurin Beuggert (Science et Cité) et Diego Hättenschwiler (wikipédien bénévole), le pouvoir transformateur de Wikipédia pour la diffusion et l'accessibilité du savoir scientifique a été mis en évidence. Voici un résumé des principaux points discutés lors de l'atelier.
| Nikola Stosic est chef de projet dans le domaine des sciences citoyennes chez Science et Cité. |  |
La pertinence de Wikipédia pour la science et les sciences citoyennes
Wikipédia et les sciences citoyennes sont étroitement liés par leur focalisation commune sur la participation de la communauté, la collaboration ouverte et la diffusion des connaissances. Ces deux initiatives reposent sur les contributions de bénévoles : Wikipédia est alimentée par des " Wikipédiens ", tandis que les projets de sciences citoyennes dépendent de la participation de citoyen-ne-s scientifiques. Les deux plateformes encouragent une collaboration ouverte, à laquelle chacun-e peut contribuer, et rendent leurs informations et données librement accessibles. En outre, elles ont un fort aspect éducatif en partageant le savoir et en enseignant des méthodes scientifiques. Grâce à la participation de la communauté, elles permettent aux individus de participer activement à la production et à la diffusion des connaissances, contribuant ainsi à un réservoir de connaissances mondial.
Wikipédia est plus qu'une simple encyclopédie ; c'est un écosystème de connaissances dynamique. Elle offre une plate-forme sur laquelle les informations scientifiques peuvent être rapidement diffusées, mises à jour et rendues accessibles. Avec plus de 2 milliards de visites par mois et environ 10.000 consultations par seconde dans le monde entier, Wikipédia touche un large public qui, autrement, n'aurait peut-être pas accès aux publications scientifiques. Cette énorme portée fait de Wikipédia un outil indispensable pour rendre les connaissances scientifiques accessibles à un large public.
Potentiels pour la communication scientifique
Wikipédia permet aux chercheuses et chercheurs de présenter leurs recherches à un public mondial sans les obstacles des canaux de publication traditionnels. Cela favorise la démocratisation du savoir et garantit que les informations scientifiques importantes soient librement accessibles. Grâce à la structure ouverte de Wikipédia, les chercheurs et chercheuses de différentes disciplines peuvent collaborer et partager leurs connaissances. Cela favorise non seulement la diffusion, mais aussi le développement des connaissances par un effort collectif. Les articles de Wikipédia peuvent être mis à jour rapidement et facilement, ce qui est particulièrement avantageux dans les domaines scientifiques qui évoluent rapidement. Ainsi, les nouveaux résultats de recherche peuvent être intégrés en temps réel et le public peut toujours être tenu au courant des dernières nouveautés.
Malgré les nombreux avantages, il existe également des défis à prendre en compte lors de l'utilisation de Wikipédia pour la communication scientifique. Comme Wikipédia est éditée par des bénévoles, l'assurance qualité représente un défi permanent. La communauté scientifique et les éditeurs expérimentés de Wikipédia sont ici sollicités pour s'assurer que les contenus sont corrects et fiables. Les articles scientifiques sur Wikipédia doivent être rédigés de manière neutre et compréhensible pour les profanes. Cela exige des chercheurs qu'ils soient capables d'expliquer des sujets complexes de manière claire et concise, sans pour autant perdre en précision scientifique. Tous les sujets scientifiques ne répondent pas aux critères de pertinence de Wikipédia. Les chercheurs doivent s'assurer que leurs contributions sont suffisamment étayées et pertinentes selon les lignes directrices de Wikipédia.
Wikipédia offre un grand potentiel pour la communication scientifique. Grâce à la participation active de la communauté scientifique, la qualité des contenus peut être assurée et élargie. L'atelier "How to Wiki" a démontré que Wikipédia n'est pas seulement une plateforme de diffusion des connaissances, mais aussi un outil permettant de rendre la science plus accessible et plus inclusive. Les chercheurs et chercheuses sont appelés à exploiter ce potentiel et à contribuer activement à l'amélioration et à l'extension des contenus de Wikipédia.
25 juin 2024
Informations complémentaires :
Ici tu trouves la présentation de l'atelier
Impressions :
Co-Create and Connect : Rencontre du réseau de sciences citoyennes en Suisse
Sous la devise "Co-Create and Connect", nous avons réuni le 29 juin 2023 des responsables de projet engagés de la communauté de tous scientifiques.
L'objectif de la rencontre était de faire avancer le développement de notre plateforme tous scientifiques et de recueillir des feedbacks ainsi que des propositions pour améliorer les contenus et les fonctions de la plateforme. Dans une atmosphère inspirante et interactive, les participants ont présenté leurs défis et leurs idées lors de différentes sessions de breakout.
Notre travail s'est basé sur l'approche du design thinking, qui se concentre sur les besoins et les perspectives des utilisatrices et utilisateurs. Les étapes méthodologiques du design thinking, de l'analyse des problèmes à la création de prototypes et à l'itération continue, nous ont permis de développer des solutions innovantes.
Lors des sessions de breakout, les thèmes suivants ont été discutés et de précieuses perspectives ont été acquises :
- Transfert de connaissances avec et pour les Citizen Scientists
- Représentation des intérêts et visibilité des sciences citoyennes
- Recrutement des Citizen Scientists et leur engagement à long terme dans le projet
- Financement de projets de recherche "non classiques".
- Communication avec les journalistes
La réunion du réseau a été l'occasion d'apprendre les uns des autres, d'échanger et de travailler ensemble à des solutions. Nous remercions chaleureusement tous les participants pour leur engagement actif et leurs précieuses contributions.
Tu trouveras plus d'informations sur les discussions dans la présentation.
Représentation des intérêts et visibilité des sciences citoyennes

Transfert de connaissances avec les Citizen Scientists

Recrutement de Citizen Scientists

Financement de projets de recherche "non classiques"

Communication avec les journalistes

24 juin 2024
Open Science Meets Citizen Science: Principaux messages et conclusions
La troisième partie du guide du groupe de travail LIBER Citizen Science pour les bibliothèques de recherche « Open Science Meets Citizen Science » offre un aperçu précieux de l'intégration des pratiques de science ouverte dans les projets de sciences citoyennes. Ce guide est une ressource pour les bibliothèques de recherche et les scientifiques citoyen-ne-s et fournit des conseils pratiques pour améliorer la collaboration, l'inclusion et l'impact. Les principaux messages et conclusions du guide sont résumés ci-dessous.
| Nikola Stosic, Chef de projet dans le domaine des sciences citoyennes chez Science et Cité. |  |
Le guide souligne les valeurs communes de la science ouverte et des sciences citoyennes, notamment la transparence, l'inclusion et l'engagement public. Ces valeurs sont essentielles pour démocratiser la science et faire en sorte que la recherche profite à l'ensemble de la société. L'importance de l'adoption des recommandations de l'UNESCO sur la science ouverte, qui mettent l'accent sur la qualité, l'intégrité, les avantages collectifs, l'égalité, l'équité et la diversité, est particulièrement soulignée.
Des étapes détaillées sont proposées pour intégrer les pratiques de la science ouverte dans les projets de sciences citoyennes, du mentorat et de la conception de l'engagement à l'éthique, la collecte, l'analyse et la publication des données. Les bibliothèques de recherche peuvent jouer un rôle important dans l'encadrement des projets et apporter leur expertise dans les pratiques de science ouverte. Une participation judicieuse et inclusive des volontaires est essentielle à la réussite de ces projets.
Le guide souligne l'importance d'une véritable inclusion et de la responsabilisation des divers participant-e-s. Les projets de sciences citoyennes éthiques doivent impliquer les participant-e-s dans les processus décisionnels et respecter leurs contributions. Il est essentiel de protéger la vie privée des participant-e-s et de garantir un consentement éclairé. L'élaboration de directives communautaires et d'un code de conduite commun peut contribuer à protéger le bien-être des Citizen Scientists.
Le « Open Hardware » permet une participation plus large à la recherche scientifique en fournissant des outils peu coûteux et adaptables. Ceci est particulièrement important pour les environnements et les contextes à ressources limitées dans le Sud mondial. Des exemples tels que Audiomoth et OpenFlexure montrent le potentiel de l'Open Hardware dans différentes applications, de la surveillance de la biodiversité aux services de santé.
La nomination d'un Wikimédien en résidence peut aider les institutions à diffuser les résultats de leurs recherches sur des plateformes populaires comme Wikipedia et à améliorer l'engagement du public et sa collaboration. L'utilisation de Wikipédia et de Wikidata permet une participation active et une collaboration du public, rendant ainsi la recherche plus accessible et plus interactive.
Avec la disponibilité croissante des données personnelles grâce aux applications et aux wearables, il est important d'utiliser ces données de manière éthique. Des plateformes comme Open Humans offrent un cadre pour une utilisation sûre et éthique des données dans les projets de sciences citoyennes. Des projets tels que Quantified Flu illustrent la manière dont la recherche dirigée par la communauté peut utiliser les données personnelles au profit de la santé publique, tout en respectant la vie privée et le consentement des participant-e-s.
Le guide « Open Science Meets Citizen Science » propose une feuille de route complète pour l'intégration des pratiques de science ouverte dans les projets de sciences citoyennes. En adoptant ces pratiques, les bibliothèques de recherche peuvent promouvoir une recherche plus inclusive, plus transparente et plus efficace. L'adoption des valeurs de la science ouverte et l'utilisation d'outils et de plateformes innovants contribuent à démocratiser la science et à accroître son utilité sociale.
Pour plus de détails, visitez le groupe de travail LIBER Citizen Science et explorez le guide complet sur Open Science Meets Citizen Science.
12 juin 2024
Pour en savoir plus sur le sujet :
- Article de blog Citizen Science Projekte in und durch Forschungsbibliotheken de Stefan Wiederkehr, bibliothécaire en chef Spezialsammlungen / Digitalisierung à la Zentralbibliothek Zürich (ZB) et membre de LIBER AG Citizen Science.
- Citizen Science et Open Science : introduction et webinaires de formation continue de la groupe de travail D-A-CH
GT LIBER Citizen Science
LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) a été fondée en 1971 sous l'égide du Conseil de l'Europe et réunit aujourd'hui environ 440 bibliothèques européennes nationales, universitaires et de recherche. Le groupe de travail LIBER sur les sciences citoyennes existe depuis 2019 et a pour mission de promouvoir les sciences citoyennes dans le cadre du paradigme plus large de la science ouverte.
Les sciences citoyennes pour le développement durable
| Christelle Ganne-Chédeville, co-responsable du développement durable à la BFH. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. |  |
Les sciences citoyennes mobilisent et permettent la participation et l'implication des citoyen·ne·s dans les projets de recherche. Mais comment les institutions de recherche peuvent-elles encourager davantage leurs esprits créatifs à utiliser cette méthode ? Surtout lorsqu'il s'agit de défis sociétaux comme la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) ? Les sciences citoyennes constituent und outils pour la recherche sur le développement durable. La Haute école spécialisée bernoise (BFH) a défini les sciences citoyennes comme champ d'action dans sa stratégie 2023-2026 "Au cœur de la société" et avec la création du champ thématique stratégique Développement durable.
Financement initial pour les sciences citoyennes à la BFH
C'est dans ce but que le domaine thématique stratégique Développement durable a lancé un appel à projets, dans le cadre de son programme d'encouragement interne en février 2024, pour les sciences citoyennes pour le développement durable. Les équipes de recherche interdépartementales de la BFH peuvent ainsi obtenir un financement initial pour la préparation de projets interdisciplinaires de grande envergure avec la participation de citoyen·ne·s. Jusqu'à 40'000 CHF sont attribués par projet. Avec une clôture de l'appel en avril 2024, les premières initiatives devraient pouvoir démarrer au second semestre 2024.
S’unir et concevoir
Le 6 février, les deux unités de la BFH en charge des thèmes stratégiques du développement durable et de la commission de recherche ont organisé un atelier à la BFH afin de former des équipes interdisciplinaires et d'esquisser des idées de projets possibles. Tiina Stämpfli et Nikola Stosic de Science et Cité ont accompagné l'événement avec de précieux inputs sur la conception et l'évaluation de projets ainsi que des aperçus de leur travail sur la contribution des sciences citoyennes aux ODD. Les participant·e·s ont eu la possibilité de présenter brièvement leurs idées et de trouver des alliés dans le cadre d'un travail de groupe.
Questions et conclusions
Les questions importantes pour cet atelier étaient les suivantes : à quel moment du projet les sciences citoyennes sont-elles envisagées ? Quelles sont les chances et les défis ? Dans quelle mesure le dialogue avec la société est-il encouragé par le projet ? Comment un tel projet peut-il être couronné de succès ?
Qu'il s'agisse d'échantillons culturels, de communautés d'entraide, de défis dans le développement urbain, d'installations pour les jeunes délinquants, de la contribution de l'IA au confort intérieur ou encore du renoncement et de la suffisance, les groupes ont réfléchi sur le degré de participation, le nombre judicieux d'itérations dans le processus des sciences citoyennes, l'importance de l'ouverture envers les citoyen·ne·s, le dédomagement et la prévention des conflits possibles dans vis-à-vis du quotidien des citoyen·ne·s. Voici les conclusions importantes de l’atelier :
- La méthode des sciences citoyennes doit être envisagée très en amont, avant même le financement initial, afin de pouvoir être mise en œuvre en toute sécurité.
- Les sciences citoyennes présentent un grand potentiel. La population est motivée pour participer à de tels projets. Les mesures de soutien aident à surmonter les obstacles financiers.
- La science a actuellement besoin d'être mieux évaluée dans la société. Lorsque les citoyen·ne·s sont impliqués, ils portent la thématique dans la société et favorisent ainsi la compréhension générale de la recherche.
As-tu encore des questions ? Contacte l'équipe Développement durable de la BFH.
20 mars 2024
Les sciences citoyennes et les Objectifs de développement durable ODD
Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies offrent un cadre global pour le développement durable. Les sciences citoyennes, l'implication du public dans la recherche scientifique, jouent un rôle important dans la réalisation de ces objectifs. Nous mettons ici en lumière la manière dont les sciences citoyennes peuvent contribuer à la réalisation des ODD ainsi que les potentiels et les défis qui y sont liés. Nous acceptons volontiers les contributions et les remarques qui complètent les développements en rapport avec les sciences citoyennes et les objectifs de durabilité en Suisse et qui permettent d'approfondir ce coup de projecteur.